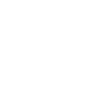Prison songs
 Film en compétition réalisé par Joshua Gilbert, produit par Beyond West (56 minutes, Australie, 2015)
Film en compétition réalisé par Joshua Gilbert, produit par Beyond West (56 minutes, Australie, 2015)
La situation carcérale en Australie concerne avant tout les aborigènes, souvent victimes de discriminations, d’abus d’autorité voire de racisme, souvent victimes d’arrestations infondées. C’est le cas de la prison mixte de Berrimah, plus grand centre pénitentiaire régional située au Nord de l’Australie où sont incarcérés 800 détenus, dont 80% d’aborigènes. Le projet porté par Joshua Gilbert, le réalisateur, vise à rendre les détenus acteurs lors de la réalisation de chansons, écrites et chorégraphiées par Shelly Morris, chanteuse et compositrice aborigène. C’est donc un documentaire atypique, chanté et dansé, qui nous plonge dans un milieu pénitentiaire surprenant.
La vie semble comme suspendue dans le temps à « Berrimah Hilton », comme l’appellent certains détenus. Entre le Bloc L, où la sécurité est minimum, le Bloc J (secteur des femmes) et le Bloc M (secteur des hommes), les rapports entre les détenus sont particulièrement pacifiques, chose rare en prison. Les groupes se forment généralement en fonction des tribus d’appartenance des détenus, en portant un fort respect envers leurs pratiques culturelles, attentifs à perpétuer leurs pratiques traditionnelles malgré l’isolement, la rupture avec les proches et la famille. « Nous sommes tous nés dans le Bush, près de la nature, au contact avec nos anciens et nos traditions. Ici, en prison, je vis pour cette Nature, pas pour rendre honneur à cette justice que l’on nous impose, à nous, aborigènes. Car en prison, tu es triste, tu pleures seul… Mais ton esprit reste libre, regarde au dehors, attend de rejoindre le Bush. Au final, la seule peine que l’on endure, c’est celle que les blancs nous imposent à travers leur système, qui n’est pas le nôtre » déplore un prisonnier, le regard vide, impuissant face à sa situation.
Outre la découverte de la vie pénitentiaire, le spectateur prend conscience de la réalité sociale, humaine, qui perdure en Australie face à la question de la reconnaissance des valeurs aborigènes, de leur culture et de leurs traditions. Pourtant, c’est bien cette population qui est la plus fortement concernée par les peines d’incarcération. En cause l’alcool, l’usage et la dépendance aux drogues, ainsi que la violence conjugale et familiale. 90% des détenus sont directement concernés ou impliqués dans ce type de violence. Souvent des cas extrêmes d’illettrisme, de détresse familiale ou encore de décrochage professionnel mènent ces individus à sombrer dans les dépendances. Comme Dale, « demi » de père aborigène, rejeté par sa famille maternelle car trop bronzé, rejeté par sa famille paternelle car trop blanc. Seul l’alcool a su lui apporter du réconfort, ou du moins lui permettre d’oublier ses différences, d’accepter son rejet familial. Ou encore Renato, abandonné par son père alors qu’il était encore un nourrisson puis orphelin de mère à 5 ans. Adulte, c’est sa compagne qui décède jeune, et le plonge à nouveau dans une situation d’extrême détresse, de souffrance et de solitude. Ce qui le pousse à tenter deux suicides, « sans parvenir à en finir pour autant ! À croire que c’est un coup du sort, ou peut-être que j’ai bien une mission, et qu’elle est en dehors de ces murs… » confie-t-il sereinement.
Véritable moyen de réinsertion pour d’autres détenus, l’univers carcéral offre parfois un refuge à ceux qui n’ont plus rien ou ont tout perdu. « Si je ne me pardonne pas moi-même, personne ne le fera », témoigne Renato. Il leur offre aussi la possibilité de s’instruire et de se former à un métier, souvent manuel. Car il faut rappeler que 76% des détenus n’ont jamais eu d’emploi avant leur incarcération, et que le taux d’illettrisme est particulièrement élevé chez les aborigènes. Pour ceux-là, le séjour carcéral est un moyen de se réconcilier avec soi, en réhabilitant l’image fragile que ces écorchés vifs traînent depuis leur enfance.
Avis du public – Raihau, Parisea et Kiehiva, étudiants à l’école Poly3D
Un sujet intéressant, et de notre point de vue d’étudiants en audiovisuel, nous sommes agréablement surpris par le travail technique : la bande son est bien travaillée, en plus elle vient illustrer avec humour et dérision des situations pourtant bien plus dramatiques ; la mise en scène est originale, on imagine le travail que ça a dû représenter, sans parler de la coopération qu’ont apporté les prisonniers ! Pour un avis plus personnel, on a tendance à s’identifier avec le message que portent ces détenus aborigènes, victimes de discrimination illégitime, que l’on peut (dans une moindre mesure) retrouver parfois à Tahiti.
Rencontre avec Shelly Morris – Inside the doc
Comment ce projet si particulier a-t-il été initié et quel a été votre rôle ?
Shelly Morris : Le concept d’introduire un travail musical et chorégraphique dans un milieu pénitentiaire, en impliquant les détenus à travers le chant et la danse, est un concept venu d’Angleterre. Lorsque le projet australien nous a été proposé, je me suis d’abord occupée d’entamer et de mener à bien les discussions avec les autorités et le personnel pénitencier pour les impliquer. Un travail fastidieux qui a duré plus de 6 mois. Lorsque l’on a obtenu l’autorisation de travailler avec les détenus, il a ensuite fallu prendre le temps de faire connaissance avec chacun d’entre eux, leur présenter le projet et parvenir à les faire devenir acteur de cette initiative. Mais comme la majorité ne savaient pas lire ni écrire, on s’est adapté et nous avons prolongé le tournage.
Justement, comment a été perçu ce projet par les détenus ? A-t-il été facile de travailler avec eux ?
Shelly Morris : Étant moi-même aborigène, je suis personnellement très sensible à leur situation, à l’histoire de chacun. En général, tous les aborigènes ont au moins un parent en prison, souvent pour les mêmes motifs (drogue, alcool ou violence). Lorsque nous leur avons présenté le projet, la plupart l’on très bien perçu et y ont de suite adhéré. Pour d’autres, cela n’était pas bien accueilli, je pense qu’ils l’ont perçu comme une sorte d’intrusion dans leur triste sort. Par exemple, ça n’a pas été facile avec les femmes au début. Souvent honteuses de leur condamnation, j’ai dû négocier avec Molly, ancienne alcoolique, qui joue le rôle de responsable du groupe des femmes. Une fois que Molly a accepté, toutes les femmes ont suivi ! Au niveau de l’ambiance, l’équipe de production n’a pas été confronté à aucune forme de violence, ni ne s’est sentie en insécurité. L’ambiance est vraiment pacifique entre tous les détenus, qui sont très solidaires entre eux. On ne peut pas en dire autant des surveillants et autres responsables administratifs…
Et quel a été l’accueil du public australien ?
Shelly Morris : Un bon accueil dans l’ensemble, même s’il est vrai que nous avons également été confronté à des positions parfois opposées à notre démarche. D’abord, de la part de certaines victimes ou familles de victimes, qui ne comprenaient pas comment l’on pouvait présenter sous un autre jour ces criminels. Alors que notre démarche n’a jamais porté atteinte aux victimes, ça n’était d’ailleurs pas le sujet. Du reste, l’accueil a été très bon, notamment chez les aborigènes ! Les nombreuses diffusions ont permis d’impliquer des « blancs » dans notre lutte, qui ont rejoint spontanément notre cause. Et sans parler des acteurs internationaux qui peu à peu véhiculent une image différente des aborigènes.